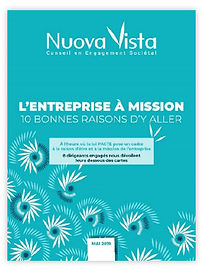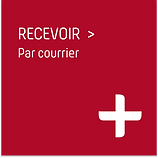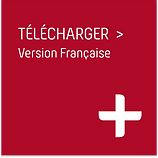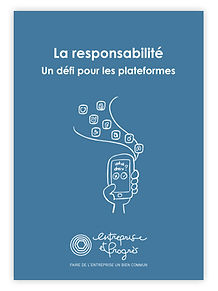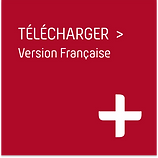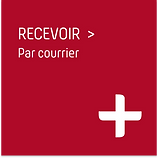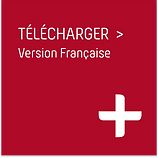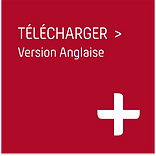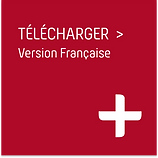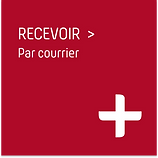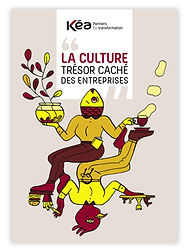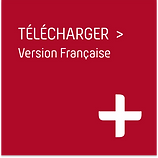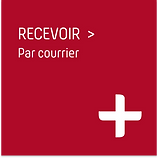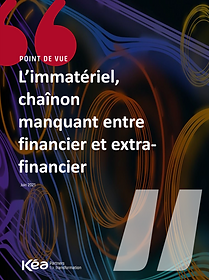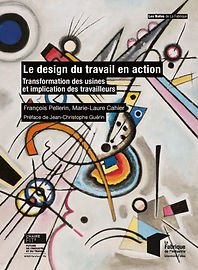Un article de Corinne Patarin, Partner & Fondatrice d’Arkos
La transformation est le chantier permanent des dirigeants. Les programmes sont ambitieux et se conçoivent au plus haut niveau de l’entreprise. Les plans de communication, sensibilisation, formation et déploiement sont là pour en assurer la réussite.
Mais voilà, sur le terrain, quand il faut concrètement mettre en œuvre la transformation, quand il faut concrètement changer, ça frotte, c’est plus difficile que prévu dans les plans et les jalons se décalent.
Et pourtant, les dirigeants passent un temps fou à expliquer l’ambition, son bien-fondé, à démontrer par A + B que la transformation proposée est la bonne, est bien celle qu’il faut pour l’entreprise. Mais non, même si l’ambition peut être comprise et acceptée, force est de constater que l’intention ne suffit pas.
Alors quoi ? Même si nous en avons envie, nous ne changeons pas ? En fait, l’intention est louable mais insuffisante : il manque sa traduction concrète pour les équipes ? Comment vont-elles (peuvent-elles ?) traduire cette intention en pratique ? En combien de temps les comportements de chacun vont-ils se transformer ? Comment les équipes vont-elles s’y prendre ? par quoi commencer ? et les autres, vont-ils changer ? Si je fais un premier pas, les autres vont-ils suivre ?
Alors comment passer de l’intention à l’action, concrètement !
Pour passer du travail prescrit au travail réel, changer les pratiques et les comportements, il faut faire preuve d’écoute, de plasticité et de confiance. Il s’agit de confronter l’intention stratégique à la vraie vie. C’est un chemin fait de rencontres, d’échanges, de mises en situation, de mises en confiance, de jeux et de rituels. Et cela, à tous les échelons hiérarchiques de l’entreprise, avec la conviction que chacun, à son niveau, est un sachant intelligent.
Clé numéro 1 : pari sur l’intelligence
Prenons l’exemple d’un changement organisationnel. Sur le papier, une organisation cible est explicitée, avec à la clé de nouveaux flux, fonctions, rôles et tâches. En réalité, quand on va à la rencontre de celles et ceux qui vont la mettre en œuvre, une multitude de cas émergent que personne ne pouvait imaginer a priori et ne pouvait prendre en compte dans le schéma cible, faute de temps et de complexité pour se mettre d’accord avec le comité de direction.
Tout d’abord, pour que la démarche soit éclairante et mobilisatrice, tous les acteurs de l’entreprise doivent être traités en adultes conscients et intelligents, sujets et non objets de la transformation à mener. C’est en faisant faire à tous le chemin qu’a pu suivre le comité de direction : analyse du terrain de jeu de l’entreprise, questions posées par la concurrence, l’environnement… qu’ils peuvent construire leurs propres convictions et commencer à se projeter. C’est en créant l’espace et les conditions pour ce cheminement dialectique de chacun et en faisant le pari de l’intelligence de tous qu’un rassemblement mobilisateur devient possible.
Clé numéro 2 : recueil de la réalité
Pour ce faire, le matériau c’est la réalité. En allant à la rencontre des équipes sur le terrain (rencontre et non pas interview et grille de questionnement), en les écoutant, en utilisant nos sens, des cas concrets de mise en application de la nouvelle organisation vont se dessiner : « ah oui, j’ai compris : quand il se passe cela, il faut faire cela ! ».
Ce recueil va permettre de mettre la nouvelle organisation en situation à partir de cas réels, de la modéliser en miniature, de la jouer… pour la rendre concrète et aider chacun à s’y projeter, en utilisant des moments clés qu’ils vivent concrètement. Pour cela, il faut de la plasticité pour s’approprier la réalité des métiers de chacun et savoir la restituer dans un modèle d’organisation clair, simple… et surtout opérationnel.
L’exercice de la fiche de poste qui est distribué à chacun (dont on ne retient que 10%) est alors inversé : plutôt que d’imposer de nouvelles tâches par des « il faut » et « vous devez », c’est un travail de récolte de situations concrètes, au plus près du terrain, afin de les simuler dans des ateliers d’expérimentation non théoriques. Ces ateliers vont alors provoquer des déclics et questionner les comportements et représentations en place pour pouvoir par la suite les bouger.
Par exemple, la représentation du « client roi » pour l’un n’est pas la même pour un autre : Un hôte de caisse peut avoir en tête l’image d’un client voleur par nature qu’il faut surveiller, débusquer – alors que, dans les faits, cela ne représente que 2% des clients et que la relation avec les 98% restants en est faussée.
Clé numéro 3 : le cascading, la durée et la répétition
Une fois l’organisation modélisée en miniature à travers des cas mis en scène en vidéos, en jeux digitaux, en jeux de plateau, en damiers, en cartes à jouer, etc… les équipes disposent d’outils sur-mesure faisant vivre des expériences transformantes.
C’est le comité de direction qui va vivre le premier l’expérience de ce « kit on the job » et ainsi pouvoir valider que c’est bien cela qu’ils veulent. Ensuite chaque membre du comité de direction va animer l’expérience auprès de ses N-1 et ainsi de suite pour engager toute l’entreprise. Ce faisant, les doutes et les peurs sur la mise en œuvre s’expriment, les convictions aussi. Le changement de représentation et de comportement s’amorce.
Les kits on the job sont animés toutes les semaines avec les équipes, dans LEURS rituels (pour éviter d’empiler des tâches dans des agendas déjà chargés). On mise sur la durée et la répétition : si l’attention est portée ainsi toutes les semaines sur la relation client, la relation avec les clients va changer et de même si mon management incarne cette relation client, je vais avoir tendance, par mimétisme à changer ma relation client. Peu à peu de nouvelles pratiques remplacent les anciennes. Il faut répéter un comportement en situation pendant 20 jours pour l’adopter, 6 à 9 mois pour l’ancrer dans sa pratique. Il faut un an pour cranter réellement de nouveaux comportements dans toute l’entreprise.
Clé numéro 4 : bienveillance et dédramatisation
Nous sommes tous interdépendants : on joue et on résout collectivement. L’approche est bienveillante, ludique, dédramatisante : elle encourage à la prise de risque… d’autant plus que dans le cadre du jeu, dans le cadre de la simulation, on ne risque rien !
Pour résumer en quelques mots :
- Écouter et comprendre les interrogations des équipes sur le terrain
- Récolter des situations réelles à confronter à l’intention stratégique du programme de transformation, via des rencontres, du côte à côte, des focus groupes
- Outiller des ateliers d’expérimentation (déclic et changement de pratique)
- Animer et faire animer ces ateliers, du comité de direction au chef d’équipe
- Ancrer par la répétition et le rituel :
C’est ainsi que l’on rend opérationnelle une transformation complexe et concernant un grand nombre d’acteurs.