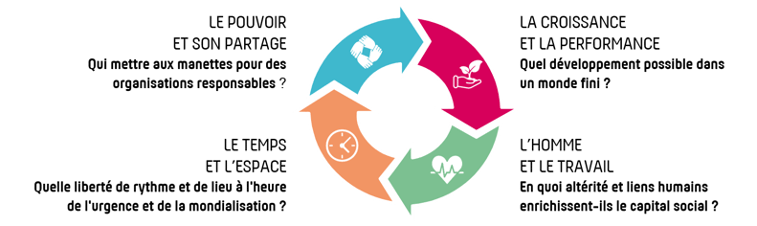Un article rédigé par François-Régis de Guenyveau, Directeur R&D du pôle Impact & Transformation responsable
Responsabilité : la grande transformation

DieselGate, procès France Télécom, condamnation des géants technologiques, boycott des marques jugées trop polluantes, nouvelles réglementations… « L’eau monte » dans les entreprises et le phénomène est parfois si rapide qu’il peut sembler nouveau. En réalité, la responsabilité a toujours été le grand moteur de l’entreprise. Chaque phase du capitalisme a donné lieu à une nouvelle critique, donc une nouvelle injonction responsable, forçant les organisations à se réinventer. Ce qui est nouveau depuis 20 ans, c’est la nature de la responsabilité et la vitesse de la transformation des entreprises. D’une logique de conformité aux lois, nous sommes passés à une contribution aux biens communs qui doit se refléter désormais au cœur de l’activité.
Entreprise & responsabilité : 2 siècles d’amour et de haine
19ème : pendant que Dickens explore les bas-fonds du Londres ouvrier, von Mohl plaide en faveur de comités ouvriers dans les usines. Première responsabilité incarnée par les lois sociales : préserver la santé physique des travailleurs.
Début 20ème : Ford exporte le travail à la chaîne et Charlie Chaplin se laisse avaler par les rouages de notre folie mécaniste. Deuxième responsabilité, que l’entreprise n’endossera qu’à moitié étant donné l’urgence de la guerre : assurer l’employabilité du travailleur face à l’hubris technique.
Trente Glorieuses : opulence, croissance, matérialisme. L’Occident devient le théâtre de l’érotisation du shopping. La critique s’exprime dans le rapport Meadows, dans les courants New Age, sur les pelouses de Berkeley envahies par une herbe d’une autre espèce ou encore dans le tube de John Lennon, Lucy in the Sky with Diamonds, aux initiales plus que suggestives. Troisième responsabilité, que l’entreprise peine encore à endosser : régénérer la Terre dont nous détruisons impunément les ressources.
Fin 20ème : mouvement, vitesse, changement permanent. Pendant que Gordon Gekko palpe ses millions à Wall Street, Patrick Bateman ne trouve plus de sens à son travail et verse dans la psychopathologie. C’est le début des bullshit jobs et des burn out. Quatrième responsabilité : veiller à la santé mentale des travailleurs.
Et ces dernières années ? Changement de cap ?
Nous assistons à une conjonction inédite de toutes les responsabilités et de toutes les critiques, attisées par les crises de 2001, 2008 et 2020. Décarbonation, inclusion, autonomie, épanouissement, contribution à la société : jamais le capitalisme ne s’est vu attaqué sur tant de fronts à la fois ; jamais les dirigeants d’entreprise ne se sont sentis aussi engagés à jouer collectif. Nous passons de la pulsion à la vertu, de la croissance à la contribution, du paradigme de la conquête à celui de la responsabilité, avec tous les espoirs et les dangers que représente un tel basculement.
Kea a été fondé il y a 20 ans avec l’ambition d’accompagner les dirigeants dans cette transformation de longue haleine. Sa raison d’être a toujours été de construire une troisième voie entre le statu quo et l’activisme. Ni laisser-faire donc, ni mythe du grand soir : l’optimisme de combat, pour reprendre Philippe Aghion [1], résume notre ambition. Le goût de la responsabilité, oui, mais sans renoncer à l’action et la liberté d’entreprendre.
2001 – 2021 : Le marché se transforme vers plus de responsabilité, Kea aussi
2001 : pendant qu’Enron fait faillite et que la bulle Internet éclate, donnant tort à la stratégie court-termiste des investisseurs, Kea naît avec l’idée d’un partnership très ouvert pour garantir le partage de la valeur créée et la transmission du capital des plus anciens aux plus jeunes.
2004 : l’Occident est en panne de croissance, l’Insee multiplie des rapports alarmistes. Chacun se creuse la tête pour trouver de nouvelles sources de valeur. Dans la Revue de Kea n°2, Michel Bon fait de la responsabilisation et de la construction d’un projet commun la clé des stratégies de croissance de demain.
2009 : France Télécom est frappée par une vague de suicides dans le cadre de son plan de transformation. Quelques années plus tard, elle sera la première entreprise du CAC 40 à être condamnée pour harcèlement moral. Dans la Revue de Kea n°12, Jean-Christian Fauvet partage les trésors de la sociodynamique, qui vise à rendre les hommes et les femmes acteurs de la transformation de leur entreprise. Jean-René Fourtou retrace de son côté ce que cette discipline responsable lui a apporté chez Bossard puis Vivendi, tandis que le philosophe François Jullien explore les vertus des transformations silencieuses comme façons de concevoir la stratégie.
2011 : la COP-17 débouche sur la « Décision de Durban », qui reconnaît que tous les pays doivent faire face de manière urgente à la menace grave et potentiellement irréversible des changements climatiques. En parallèle, nous menons le débat avec Michel-Edouard Leclerc et Franck Riboud sur le développement durable et son implication dans l’exercice stratégique des dirigeants, sans langue de bois, devant un parterre de 200 personnes du monde économique.
2014 : la loi Économie sociale et solidaire est votée à l’Assemblée. Elle vise à reconnaître et valoriser ce mode économique spécifique et à provoquer un choc coopératif partout en France. Le Groupe Kea s’inscrit dans cette dynamique en s’associant à la création de Co Conseil, une coopérative de conseil à but non lucratif, sous l’impulsion de Syntec Conseil et en partenariat avec 3 autres cabinets fondateurs.
2018 : soucieux d’incarner nos valeurs dans tous les pays où nous intervenons, nous souhaitons renforcer notre engagement sociétal en Afrique et en Asie. L’accès aux soins, dans un contexte d’explosion démographique, nous apparaît comme prioritaire. Dans cette optique, Kea noue un partenariat stratégique avec Tech Care For All : une start-up de l’économie sociale & solidaire qui commercialise des solutions d’e-santé et en assure le déploiement en s’appuyant sur des réseaux d’entrepreneurs locaux ainsi que sur de grands bailleurs de fonds présents en Afrique et en Inde.
2019 : Facebook et Cambridge Analytica, procès Uber, Amazon assigné en justice par Bercy… Les plateformes sont dans le collimateur. Le think and do tank Entreprises et Progrès [2] nous demande d’animer un cercle de réflexion sur le sujet. Un livre blanc s’en fait l’écho : tout en reconnaissant l’ultra performance de ces modèles économiques, il pose la question centrale du partage de la valeur. Irresponsables, les plateformes ? Pas forcément si l’on se dote d’institutions de régulation adaptées.
2020 : la loi Pacte est promulguée : l’ambition est de faire des entreprises le premier levier de la transformation économique du pays. Kea devient le 1er cabinet européen de conseil en stratégie à adopter la qualité de « Société à Mission ». À la fin de l’année, 88 entreprises ont elles aussi franchi le pas en France ; elles sont une centaine en février 2021 et le mouvement s’amplifie au fil des mois.
Dans la Revue n°24, nous donnons la parole à des dirigeants et philosophe sur leur conception de la transformation en et vers la responsabilité, en contrepoint des grandes lignes de notre démarche.
2021 : B Corp constitue une communauté de quelque 3000 entreprises engagées dans la transformation responsable de l’Économie. Kea la rejoint officiellement en mars.
Côté clients, nous apportons un modèle de référence pour transformer leur entreprise pas à pas et contribuer à un monde économique à impact positif. Nous sommes également partie prenante du do tank « Faire! Mieux » qui a pour vocation d’engager la transformation positive du secteur alimentaire sous forme de coalitions de projets.
Le monde d’après ? Ou l’après Covid ?
Bien malin celui qui peut le prédire, mais certaines tendances se dessinent.
Le périmètre de la responsabilité va continuer de s’étendre. Car, au-delà de sa dimension réglementaire et normative, elle devient un avantage compétitif pour l’Europe, un projet de civilisation. Entre le « capitalisme transnational de plateforme » (Etats-Unis) et le « capitalisme à forte impulsion étatique » (Chine) [3], l’Europe va tenter de construire un « capitalisme démocratique », au service des citoyens, fondé sur la recherche du bien-être, l’éducation, la santé, la culture.
Le défi, bien que globalement plébiscité par la population, est, cela dit, loin d’être relevé. L’Europe peine à le réaliser et à s’imposer en dehors de ses frontières : non seulement elle dépend de l’outillage technologique des deux autres capitalismes, mais elle manque considérablement de coordination politique.
Deux facteurs pourront maximiser ses chances de réussite. D’une part, des institutions capables d’organiser efficacement cette transition à l’échelle européenne, c’est-à-dire de créer les plateformes de partage adéquates, de valoriser les entreprises exemplaires, de sanctionner les resquilleurs. D’autre part, des dirigeants tenaces. Capables de traduire les enjeux RSE dans toutes les composantes clés de leur entreprise. D’éviter le blues des collapsologues et l’utopisme des candides. Et de tenir le cap contre les railleurs… La critique est aisée mais l’art est difficile !
[1] Le Pouvoir de la destruction créatrice, Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel, Odile Jacob, 2020 [2] Entreprise et progrès, association née il y a 50 ans réunissant les dirigeants sensibles à la création de valeurs et pas seulement de la valeur actionnariale. Kea est l’un des membres du comité exécutif. [3] Robert Boyer, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, La Découverte, 2020