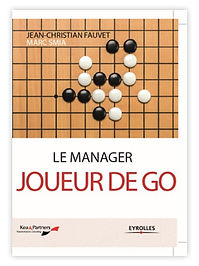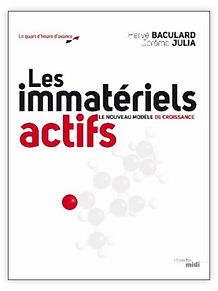Article rédigé par Hervé Lefèvre, Senior Partner et Senior Vice Président Kéa en collaboration avec Jacques Jochem

Cet ouvrage propose une grille de lecture originale, inspirée des travaux d’Edgar Morin et de Jean-Christian Fauvet, pour mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise et comment celui-ci influe sur ses performances.
Il explore la piste prometteuse du développement de l’organisation holistique, un mode de fonctionnement à base d’auto-organisation dont les possibilités sont encore largement sous-utilisées, y compris là ou faire confiance aux hommes est à l’évidence la façon la plus efficace et la plus économe pour faire face à la complexité et à l’imprévisibilité de l’environnement.
La thèse du livre
Dans toute entreprise cohabitent quatre formes d’organisation : tribale, mécaniste, transactionnelle et holistique. Chacune de ces formes a sa logique, ses valeurs de référence, ses sources d’énergie privilégiées ainsi que ses bonnes pratiques.
Chaque entreprise ou sous-ensemble de l’entreprise les marie suivant une configuration qui lui est propre : son « mix organisation ». Ce mix, volontariste ou subi, est fonction de son métier, de son environnement et de son histoire. Il est plus ou moins harmonieux et sert plus ou moins ses enjeux de performance. Dans ce « mix organisation », la forme aujourd’hui la moins développée est celle que nous avons baptisée « holistique ». Mais c’est aussi la plus prometteuse.
Sa singularité majeure est de faire plus confiance aux hommes, managers et collaborateurs, qu’aux systèmes pour faire face à la complexité irréversible atteinte à la fois par l’environnement de l’entreprise et par son fonctionnement interne. Elle permet d’installer un contexte de travail attractif pour les talents dont elle a besoin, générateur d’engagement et propice au développement de l’innovation. Trois enjeux auxquels les mix actuels à dominantes mécanistes ou transactionnelles ont de plus en plus de mal à répondre.
Il existe, encore en petit nombre, mais sous des formes parfois très poussées, des entreprises, généralement petites ou moyennes, qui se sont dotées de mix organisation à dominante holistique. Elles définissent leurs modes d’organisation de différentes manières, mais en référence aux mêmes principes dont celui d’auto-organisation. Les réflexions à leurs propos semblent se multiplier, contribuant à remettre sur l’agenda des dirigeants l’organisation de l’entreprise comme facteur de sa compétitivité. Un statut qu’elle avait perdu, parce que progressivement reléguée, au cours de ces dernières décennies, au rang de simple commodité.
Notre conviction est que beaucoup d’entreprises, et notamment les grandes, gagneraient à faire évoluer, partout où c’est possible, leur mix organisation, pour donner plus de place à l’organisation holistique. Non pour des considérations humanistes, mais parce qu’elle s’avère être, dans un grand nombre de cas, le mode de fonctionnement le plus efficace et le plus économique. La révolution digitale en cours met à leur disposition les outils qui leur manquaient pour irriguer des communautés plus nombreuses, plus diverses et plus dispersées que celles de leurs consœurs plus petites et plus localisées.
Mais nous ne croyons pas à une nouvelle mystique organisationnelle ou managériale qui conduirait, en jetant le bébé avec l’eau du bain, à « libérer l’entreprise » et à l’amener vers un utopique âge d’or. Une des raisons étant que l’organisation holistique ne peut exister seule. Pour pouvoir s’installer et prospérer, elle a besoin de s’appuyer, au sein du mix organisation, sur un socle mécaniste. Ce socle, calibré au plus juste, va apporter l’ordre, la stabilité et la continuité nécessaires à l’essor des initiatives et des coopérations.
Au sein du profil diagonal du mix organisation, il va faire office de quille du bateau.
Toute initiative visant à opérer des changements dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise devrait prendre en compte son mix organisation afin d’éviter des erreurs ou des contresens à propos de la nature des solutions ou bonnes pratiques à mettre en œuvre, ainsi que des stratégies de changement à privilégier. A fortiori si l’on a l’ambition de faire évoluer le mix lui-même, en « trans-formant » l’entreprise, c’est-à-dire en faisant passer certains éléments de son fonctionnement d’une forme d’organisation à une autre.
Éditions Eyrolles – septembre 2014
Ce livre s’inscrit dans un programme de recherche et de développement engagé par Kea & Partners afin de :
- Veiller à ce que l’entreprise reste ou redevienne un lieu de développement personnel, condition de son attractivité pour les talents dont elle a besoin.
- Corriger les dérives auxquelles la pousse la financiarisation de l’économie.
- Saisir les opportunités exceptionnelles apportées par la révolution digitale en cours
- Créer les conditions propices au développement de l’innovation.