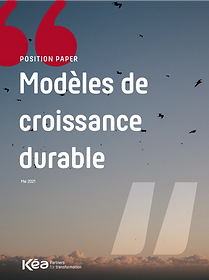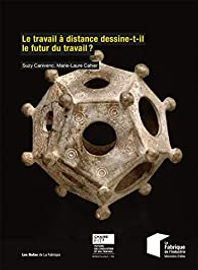Plus de 3 milliards, c’est le montant avancé le 2 avril 2020 par la Présidente de la FFA, Florence Lustman, pour donner la mesure de l’effort des assureurs en cette période de crise. Un chiffre qui date déjà, compte tenu des nouvelles annonces des assureurs.
Mais, ni les montants mis en jeu, ni l’ampleur des pertes prudentielles, ni les explications – trop techniques ? – des assureurs n’y changent rien : les Français ont le sentiment que ces derniers ne sont pas au rendez-vous. L’attention publique est aujourd’hui sur les pertes d’exploitation. Les parlementaires ont les assureurs dans leur ligne de mire. Et demain, quelle sera la perception des épargnants sur leur prise de risque pour les soutenir ? Dans son allocution du 13 avril dernier, Le Président de la République a mis sur un pied d’égalité banques et assurances : « … les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J’y serai attentif ». Aurait-il lui aussi un doute sur leur niveau d’engagement dans le futur ?
Nous n’avons nullement l’intention ici d’alimenter l’image d’Epinal de « l’assureur voleur » ou la polémique sur l’un des fonds mutualistes solidaires lancé par un bancassureur. Nous savons tous les efforts que les assureurs déploient en temps de crise, mais aussi en cas d’événement climatique local ou au quotidien dans le retour à la normale des sinistres individuels.
Au contraire, soulignons leur engagement invisible, imperceptible, tant sur le service aux assurés que dans la gestion de la résistance aux crises systémiques. Les efforts réels pour s’adapter aux normes européennes de Solvabilité 2 démontrent encore plus aujourd’hui qu’ils n’ont pas été vains, que leur utilité est réelle pour protéger le bien commun de notre société et de nos modes de vie.
Il est désormais temps de porter, au-delà du Risque, une attention stratégique au Client en mettant en lumière l’utilité et l’engagement sociétal des assureurs.
L’engagement ou la nouvelle préférence des consommateurs
Les études Brand’Gagement et Baromètre des Français menées par le groupe Kéa soulignent que l’engagement des entreprises est devenu un marqueur de l’acte d’achat : tous secteurs confondus, 84% des consommateurs l’affirmaient en 2020 ; 64 % en 2017. Autre élément : les Français estiment que 77% des marques actuelles pourraient même disparaître sans que personne ne le remarque. Une tendance de fond donc, en résonance avec l’Entreprise à Mission, amplifiée par le Covid. Les clients attendent que les entreprises aillent au-delà de la création de valeur économique, par une contribution active à l’amélioration de nos sociétés.
En dix ans, la donne a considérablement changé : le client a aujourd’hui des moyens simples d’exercer son choix, de manifester sa préférence pour l’engagement. Il suffirait d’un Yuka de l’Assurance pour pleinement rebattre les cartes du jeu concurrentiel.
Le secteur bancaire prend le devant de la scène et cela joue en faveur de son activité d’assurance : en se positionnant en première ligne du redressement économique, en tant que banquiers, ils développent une dialectique simple et compréhensible par le grand public. Depuis quelques jours, des filiales d’assurance de groupes bancaires lancent des fonds de soutien à leurs clients professionnels. Qu’importent les coulisses ou la réalité sur le terrain, le consommateur citoyen retiendra que les banquiers auront été au rendez-vous, qu’ils font partie de la solution à la sortie de crise, qu’ils se sont investis dans la bataille. Préparons-nous à des prises de part de marché !
Assureurs, quelle est votre réponse stratégique ?
La réponse des assureurs ne peut pas être uniquement financière, elle se trouve aussi dans vos organisations. Concrètement, voici des premières pistes pour réaffirmer votre engagement, rassembler vos forces au sein du marketing client et vous inspirer pour agir.
Gardez à l’esprit en les lisant, que ce qui était impossible il y a deux mois, est aujourd’hui fait.
#01 – Réaffirmer votre Engagement
Légitimité, impact, incarnation, sens et activisme : ce sont les cinq dimensions qui se dégagent de nos recherches et expériences. Des dimensions où les moyens financiers sont des moyens, non la finalité. Chaque assureur dispose déjà d’éléments pour nourrir chacune d’entre elles. Faites l’exercice, vous le constaterez par vous-même.
Mais dans ce cas, pourquoi en parler ? Pour que vous puissiez en amplifier les effets ! Car si chaque assureur chemine dans sa contribution au bien commun, force est de constater que peu en ont fait une doctrine complète, à part entière, puissante. Il est temps de tisser des liens entre ces différentes dimensions, de dégager une trame explicite pour les clients, les prospects et les autres parties prenantes. Tel l’impressionniste, combinant habilement « dessein » et touches de couleur, évitant l’éparpillement de son génie créatif, vous pouvez faire émerger votre Engagement.
Y travailler n’est ni un changement radical, ni un simple exercice de communication :
- Ce n’est pas un changement radical : les assureurs sont par nature au service du bien commun. Le secteur s’est développé sur le solidarisme, la mutualisation, le partage explicite des risques. Néanmoins, il s’agit d’inventer de nouvelles formes d’engagement en phase avec les attentes profondes des clients.
- Ce n’est pas de la cosmétique : nos études démontrent que les clients sanctionnent l’absence de preuves.
À chaque assureur sa voie singulière pour réaffirmer son engagement, de manière différenciante.
#02 – Rassembler vos forces au sein du Marketing Client
Qui est à même de coordonner les actions, connecter les différentes initiatives prises au sein de votre entreprise, être le bras armé du comité de direction ? De notre point de vue, le Marketing Client est le meilleur candidat, pour peu que celui-ci soit correctement outillé et positionné dans les processus de décision. Sa première mission sera bien évidemment de vous proposer une stratégie en matière d’Engagement.
Le Marketing Client n’est pas une idée nouvelle. Néanmoins, il n’a pas le positionnement idéal. Notre lecture des organisations et des processus de décision indique que le rapport de forces en interne tourne encore trop fréquemment à l’avantage des équipes actuarielles. Que serait devenue Apple si Steve jobs avait toujours écouté ses ingénieurs, aussi brillants soient-ils ?
La tension entre Risque / Marketing Produit et Client / Marketing Client est structurelle. Elle ne peut être annulée ou ignorée. Chaque assureur doit dans son organisation et ses processus de décision, trouver, entretenir un juste équilibre, en toute conscience, et développer des mécanismes de réelle coopération entre les trois entités. Si l’un devient « esclave » de l’autre, de la valeur financière sera perdue.
La profession avait anticipé ce rééquilibrage de la tension : le développement des services, le traitement « personnalisé » des sinistres, le développement d’une relation de proximité, affinitaire, avec certains segments de clients… Les solutions sont sûrement présentes au sein de vos équipes. Il « suffit » de leur donner la parole et les moyens d’amplifier, d’accélérer leur action.
Pour que votre Marketing Client vous aide à voir le monde avec les yeux du client en mode prospectif, de nouvelles « lunettes » sont à concevoir : observatoire prospectif des tendances client multisectoriel, compréhension des incitations profondes d’achat, utilisation intensive de la Data, intégration de la dimension RSE.
#03 – S’inspirer pour agir et agir en s’inspirant
Avec les deux premiers éléments, vous disposerez d’une stratégie et de moyens internes. Qu’en est-il de votre stratégie d’action ? Comment agir alors que l’incertitude de l’environnement est le seul élément certain ?
L’inspiration peut venir d’entreprises pionnières, françaises ou internationales, affichant d’excellents résultats qui confortent leur stratégie. Certaines marques du Groupe Unilever ont engagé des stratégies mondiales basées sur l’engagement, les Sustainable Living Brands. Résultats : leur croissance est 69% plus élevée sur les trois dernières années que les autres marques du Groupe. Un cercle vertueux s’est enclenché sur le long terme.
Quelques inspirations pour agir, issues de nos échanges avec des dirigeants du secteur :
- S’engager maintenant : c’est au dirigeant, en maître des horloges, avec son comité de direction, d’appuyer sur le bouton de l’Engagement.
- L’action prime. Le dirigeant fixe un cadre de jeu, une direction, une intention. Le reste de l’entreprise agit sur le terrain. Les actions sont ainsi mises en œuvre, en articulant court et long terme, dans ce cadre.
- L’action doit être impactante. Cela implique une focalisation stricte de l’effort, et donc un renoncement, et une rénovation progressive des modèles opérationnels industriels. L’enjeu est d’agir comme « un Colibri à l’échelle ».
- Dans cette course de fond, l’adhésion des parties prenantes est nécessaire. Avec une attention particulière à porter aux actionnaires, décideurs in fine. Les mutualistes disposent d’un avantage certain. Les assureurs privés peuvent se tourner vers des investisseurs engagés, comme BlackRock.
- Les entreprises engagées amènent la puissance publique à s’impliquer. Elles font effet de levier par leur activisme, leurs organisations professionnelles ou bien encore par des évolutions réglementaires.
- Le passage au statut d’Entreprise à Mission ou la certification B-Corp peuvent être des concrétisations de leur engagement, mais ne sont pas des points de départ.
Soyez des acteurs de premier plan du monde d’après
L’actualité pose la question du monde d’après. C’est la porte ouverte à tous les fantasmes, chacun poussant son utopie pour demain, parfois en gardant les lunettes du passé. Une chose est sure : la crise nous amène à prendre conscience de la fragilité de nos sociétés et à réfléchir à l’essentiel. Demain sera possible s’il est soutenable.
C’est pourquoi l’Engagement est une voie d’exploration pertinente. C’est une façon de revenir aux sources de l’assurance, à son utilité sociale. C’est aussi une manière habile de mettre les modèles économiques sur l’établi afin d’allier performance et contribution à l’intérêt général.
L’Engagement est une nouvelle réponse stratégique à articuler avec celles, déjà connues, de la différenciation et de la préservation des avantages concurrentiels. Plus aspirationnelle et plus en phase avec les motivations profondes de nos concitoyens. Les assureurs ont de beaux atouts en main.
L’équipe Service sous l’impulsion d’Yves Pizay, avec la contribution de Kéa Tilt