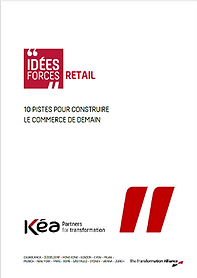Article co-rédigé avec Marianne de Chambrun, Directrice Kéa
Nous sommes convaincus que la réussite d’une entreprise n’est pérenne qu’à compter du moment où elle est en mesure de concilier sur une longue période les impératifs de l’institution qu’elle représente avec les aspirations du corps social qui la compose.
C’est pourquoi, de 2012 à 2019, nous avons mené l’enquête, grâce au Cultural Value Assessment du Barrett Values Centre (BVC), sur les aspirations des Français et sur les valeurs émergentes pour eux-mêmes, l’entreprise et la nation. Celles-ci sont mises en regard avec celles exprimées dans d’autres pays, grâce aux données du BVC, et soulignent les enjeux propres à la France.
En quoi consiste le baromètre valeurs des français ?
5 questions sont posées à un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans. On demande à ce panel de citoyens de choisir dans une liste de valeurs, les 10 qui représentent le mieux
- leurs valeurs personnelles,
- celles décrivant leur perception de la nation et du monde de l’entreprise aujourd’hui,
- celles qu’ils souhaiteraient vivre à l’avenir.
Dans la liste de valeurs ou mots, il y a des termes positifs et des termes négatifs, ces derniers sont qualifiés de valeurs freins.
L’analyse des résultats s’attache aux valeurs qui ressortent dans le TOP 10 et 20, ainsi qu’aux évolutions d’une année sur l’autre, en mesurant l’écart entre les valeurs vécues et désirées et les variations par segment de population. Certaines années, nous réalisons également des analyses d’écart par rapport à d’autres pays européens.
Les tendances observées dans la durée
Les valeurs personnelles des Français évoluent très peu dans le temps. Pour autant, nous nous attachons aux écarts mêmes très faibles afin de capter les changements à l’œuvre.
Les valeurs vécues dans la Nation se caractérisent depuis 2012 par un top 10 intégralement négatif, situation qui est répandue dans d’autres pays européens.
Les valeurs vécues dans l’entreprise restent elles toujours plus positives.
Que nous a appris le dernier baromètre (2018-2019)
L’analyse des écarts entre valeurs vécues et désirées nous montre que les Français demandent en entreprise plus de participation : respect, partage d’information, écoute, confiance ou encore management participatif et implication collective sont les vocables plébiscités.
Pour répondre à ces attentes, faut-il donc ouvrir largement le dialogue pour définir ensemble les orientations stratégiques de demain ? Pas exactement répond Arnaud Gangloff.
« L’un des défauts de l’entreprise, en particulier française, c’est que l’on y discute beaucoup et que l’on n’y agit pas suffisamment : plus qu’un dialogue large sans certitude d’aboutissement, il s’agit donc d’ouvrir à discussion les sujets sur lesquels les collaborateurs se sentent légitimes pour exprimer leur opinion, où ils ont une capacité réelle à influencer les décisions et disposent de moyens d’action. Et ce pour un objectif précis : libérer l’énergie les initiatives pour mettre l’entreprise en mouvement à tous les niveaux.
Dans le contexte de la loi Pacte, ce sont ces entreprises, dîtes à mission, qui seront le plus à même de faire bouger les lignes, c’est à dire des entreprises qui assument statutairement une responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de leurs parties prenantes, dont leurs collaborateurs. Les dirigeants s’engagent à écouter et à influer leurs positions en retour et, en contrepartie, demandent à tous de contribuer activement à la dynamique de l’entreprise ».
Un mécontentement porté par certaines catégories : les femmes, les jeunes et les chefs d’entreprise
Si la part des valeurs négatives est remontée (+0,8 point) en 2018, les jeunes (moins de 35 ans), les femmes et les chefs d’entreprise sont les catégories qui ont surpris par leur colère vis-à-vis de l’entreprise ou de la nation. Cependant, si les moins de 35 ans sont souvent critiques, les femmes et surtout les chefs d’entreprise se sont toujours montrés, depuis 2012, plus indulgents envers la nation notamment.
En 2018, les valeurs négatives sont en hausse de 3,1 points chez les femmes, de 5,1 points chez les moins de 35 ans et 16,7 points chez les chefs d’entreprise.
« En 2018, les femmes sont en décalage : plus exigeantes que les hommes dans leurs attentes sur les dimensions santé et environnement, leur perception de leur vécu dans la nation, comme dans l’entreprise est plus sévère. C’est une tendance dont les entreprises doivent tirer parti. Au-delà des enjeux d’égalité, les femmes, à travers leur sensibilité sur ces sujets d’avenir, représentent un moteur puissant pour l’entreprise afin de la mettre en mouvement et d’assurer sa transformation ».