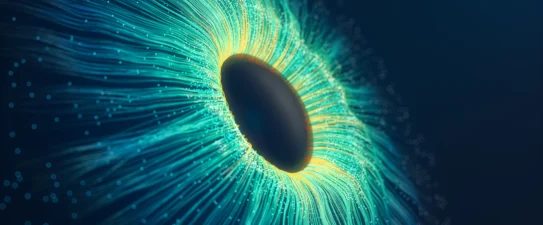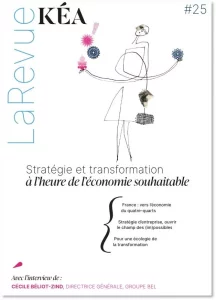Dans le secteur industriel, la disponibilité des équipements est critique, les chaînes d’approvisionnement sont sous tension et toute défaillance imprévue peut entraîner des ruptures, des surcoûts et une mobilisation sous-optimale des ressources humaines et matérielles (cf notre note sur les surcoûts liés aux défaillances machine). Aujourd’hui, une grande partie du budget maintenance est encore dédiée à la gestion réactive des incidents, un mode opératoire qui expose les groupes à des arrêts non planifiés, à une volatilité des coûts et à une pression accrue sur la performance industrielle et la compétitivité. Longtemps vue comme un serpent de mer, la maintenance prédictive a gagné en maturité. Les bénéfices sont désormais connus : une réduction de 40 % des coûts de maintenance et de 50 % des temps d’arrêt imprévus. Ceux qui ont franchi le pas y puisent un avantage concurrentiel décisif.
Un levier de valeur qui s’aborde pas à pas
La maintenance prédictive figure comme l’un des cas d’usage parmi les plus stratégiques de l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’entreprise. C’est un levier clé pour renforcer durablement la performance industrielle et la résilience de ses opérations, en témoignent les résultats évoqués dans le rapport The True Cost of Downtime 2024 :
- une amélioration de 85 % de la précision des prévisions de temps d’arrêt ;
- une réduction de 50 % des temps d’arrêt imprévus des machines ;
- une augmentation de 55 % de la productivité du personnel de maintenance ;
- une réduction de 40 % des coûts de maintenance.
Une première étape pilote permet de poser les preuves concrètes des opportunités d’un projet de maintenance prédictive à plus grande échelle grâce à une extrapolation. Cette approche progressive, fondée sur l’exploitation intelligente de la donnée (des statistiques descriptives à des modèles IA), vise à créer de la valeur dès le court terme tout en posant les bases d’un déploiement structuré de la maintenance prédictive.
Les bénéfices économiques et opérationnels attendus sont multiples :
- Réduction des coûts liés aux pannes imprévues et aux interventions d’urgence ;
- Augmentation de la disponibilité opérationnelle des équipements critiques ;
- Diminution des stocks immobilisés de pièces de rechange ;
- Contribution aux objectifs RSE, via la réduction de la consommation énergétique et l’allongement de la durée de vie des équipements ;
- Optimisation du dimensionnement des équipes internes et du recours à la sous-traitance.
Comme pour tout projet d’envergure comportant des incertitudes sur les zones de création de valeur, il est fondamental de démarrer par un diagnostic ciblé avant de projeter son implémentation globale. Nous quantifions l’existant (nombre de pannes, d’interventions, d’heures de perturbation associées à la maintenance corrective, identification des équipements problématiques) et les sources de variabilité pour définir les « poches d’inefficience » et les opportunités de gain. Ce diagnostic constitue également un excellent moyen d’aligner les équipes sur une vision factuelle, créant ainsi les conditions optimales pour identifier et prioriser les « quick wins ».
Par expérience, la Preuve de Valeur (POV), prérequis à la mise en place de transformations plus structurante ; peut se réaliser sous 8 semaines de travail sur un périmètre pilote à fort potentiel. Cette méthode permet de limiter les investissements initiaux, tout en démontrant concrètement, à travers des résultats mesurables, la pertinence et la rentabilité de la démarche d’optimisation des opérations de maintenance dans le système actuel. et à bâtir une trajectoire sur mesure.
Lors de la première phase d’un projet chez un de nos clients en 2025, nous avons pu observer les bénéfices suivants :
Levier d’optimisation :
- Réduction des coûts liés aux pannes imprévues
- Augmentation de la disponibilité opérationnelle
- Diminution des stocks de pièces de rechange
- Contribution aux objectifs RSE
- Optimisation du dimensionnement des équipes
Gains attendus :
- Moins d’interventions d’urgence
- + 10 % de temps de machine productive
- -20 % de capital immobilisé
- -15 % de consommation énergétique
- Ajustement précis des ressources internes
Nos convictions pour réussir : tester, embarquer, transformer
La modélisation prédictive, couplée à une analyse approfondie des tickets d’intervention, permet d’identifier avec précision les poches d’optimisation et de simuler les conséquences selon les scénarios de suivi de la maintenance. La réussite d’un projet de ce niveau ne dépend pas uniquement des algorithmes, mais également de l’adhésion interne, aussi bien de la direction générale que des techniciens. Lorsque ces derniers ne sont pas associés dès le départ, nous avons constaté à quel point les nouvelles solutions peuvent être perçues comme complexes, inutiles ou déconnectées du réel. L’enjeu est de faire émerger les recommandations dans un dialogue avec ceux qui vivent les machines au quotidien.
En témoigne l’exemple d’un grand groupe industriel d’infrastructures qui a rationnalisé récemment ses opérations de maintenance. Son objectif ? Gagner 20 % de productivité dans les 3 ans. L’analyse de plus de 60 000 opérations de maintenance sur 3 Business Units a permis de simuler divers scénarios d’amélioration, tels que la mutualisation des trajets des techniciens, l’implémentation d’un pilotage en temps réel et une meilleure efficience de ces professionnels en opérations. Ces ajustements doivent permettre une augmentation de la productivité entre 25 et 35 %, générant ainsi des économies considérables et une amélioration des conditions de travail.
Forts de plus de 10 années d’expérience des transformations de l’industrie, nous avons défini les quatre piliers sur lesquels repose la réussite d’un projet de maintenance prédictive :
1. La data doit servir des résultats économiques, dès le court terme.
La donnée est mobilisée au service d’un objectif clair : faire émerger des gains rapides et rentables. Les analyses à granularité fine révèlent parfois des gisements de valeur insoupçonnés.
2. La compétence métier est aussi essentielle que la technologie.
La démarche n’est efficace que si elle s’appuie sur les experts internes. Ils participent aux analyses, interprètent les résultats et garantissent la mise en œuvre opérationnelle.
3. Le test and learn n’est pas une option : c’est une méthode.
Plutôt qu’un grand plan théorique à l’échelle du groupe, nous recommandons d’attaquer par un périmètre pilote ciblé. Puis, de déployer progressivement, en mesurant les résultats à chaque étape.
4. Le ROI, élément central du pilotage.
Les analyses se structurent autour d’indicateurs économiques solides. Ces KPI sont indispensables à la décision, à la priorisation et plus prosaïquement à l’onboarding des comités de direction.
Moins de perfection, plus d’action : dépasser les freins à la transformation
Face à une promesse si forte, qu’est-ce qui explique que toutes les directions industrielles n’ont pas encore enclenché la dynamique de transformation ? Non par manque de conviction, mais parce que plusieurs freins bien concrets viennent ralentir l’élan.
Premier point d’achoppement : les données nécessaires sont rarement centralisées. Entre les historiques de maintenance logés dans des fichiers Excel, les tickets SAV saisis à la main et les systèmes de GMAO ou MES peu interconnectés, la matière première reste difficile à exploiter. Sans données accessibles, fiabilisées et suffisamment granulaires, toute ambition prédictive perd de sa crédibilité. Le diagnostic ciblé, à partir des données réellement disponibles nous permet d’avancer sur un périmètre pilote sans attendre un référentiel parfait.
Dans de nombreux groupes, les équipements diffèrent selon les sites, les pays, voire les lignes de production. Certains sont récents et déjà instrumentés ; d’autres, plus anciens, échappent à toute remontée de données automatique. Cette diversité rend complexe la mutualisation des approches et nécessite une adaptation fine des modèles selon le contexte local. L’approche sur la segmentation permet d’adapter les analyses à la réalité de chaque site.
Enfin, sans projection économique solide, il est difficile de mobiliser les décideurs. L’enjeu n’est pas seulement de démontrer qu’une approche IA fonctionne, mais de prouver qu’elle génère des économies mesurables, dans un calendrier compatible avec les attentes de retour sur investissement. Les directions attendent un chiffrage clair et robuste, c’est le rôle de la Preuve de Valeur qui permet d’engager les décisions à l’échelle du groupe.
L’IA au service des machines : la surveillance intelligente qui dope la performance
Certaines tentatives échouent parce qu’elles restent dans une logique purement technique. Modéliser, prévoir, anticiper : oui. Encore faut-il que les recommandations s’intègrent réellement dans les processus industriels, en croisant les indicateurs avec les priorités métiers. L’IA devient un outil au service de la performance, pas un nième POC qui ne se rapprochera jamais du passage à l’échelle.
Les résultats de la mise en œuvre de la maintenance prédictive cités plus haut ne disent pas tout. La surveillance de l’état des machines pilotée par l’IA va plus loin. Anticiper une panne permet de réduire jusqu’à 40 % le recours aux pièces de rechange, limitant ainsi le gaspillage et les émissions de carbone. L’énergie est optimisée, la production gagne en efficacité, et la maintenance prédictive permet de concentrer les équipes là où elles créent le plus de valeur.
Lorsque l’attention et les ressources de l’entreprise sont dédiées à la réparation des équipements et à la résolution des problèmes de production, il ne subsiste plus d’énergie ni de fonds pour favoriser l’innovation. La transition vers la maintenance prédictive n’est pas une promesse technologique abstraite. C’est une opportunité business tangible qui a l’avantage majeur de reposer sur des données existantes, une expertise métier, et sur une approche structurée, pour une transformation pas à pas.
Surcoûts liés aux défaillances : quand chaque minute d’arrêt devient une perte colossale
Avez-vous déjà quantifié l’impact d’un arrêt machine ? Qu’il soit causé par une panne, une pénurie de matériaux ou une usure non détectée, l’interruption d’une chaîne de production peut rapidement se chiffrer en milliers, voire en millions d’euros. Une seule heure d’arrêt peut avoir des conséquences en cascade : augmentation du coût salarial liée au temps improductif, surconsommation énergétique pour compenser le retard, pénalités de livraison, risques pour la réputation et dégradation de la relation client. Pour les entreprises manipulant des produits périssables, les pertes peuvent aller jusqu’à la destruction de lots entiers, comme dans la filière laitière où un délai de reprise de 24 à 48 heures est critique.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon ABB[1], le coût moyen d’un arrêt non planifié atteint 68 000 € de l’heure pour une entreprise industrielle française, et jusqu’à 116 000 € à l’échelle mondiale. 79 % des industriels français subissent au moins un arrêt par mois, contre 69 % à l’international. Le rapport The True Cost of Downtime 2024 de Siemens[2] va plus loin : les arrêts imprévus représentent désormais 11 % du chiffre d’affaires des 500 plus grandes entreprises mondiales. Face à cette inflation des coûts cachés, les industriels ont été contraints d’agir. En quelques années, l’industrie lourde a réduit d’un tiers la durée des arrêts grâce à l’adoption de technologies avancées : l’IoT pour surveiller en temps réel la santé des équipements, la maintenance prédictive (PdM) pour anticiper les pannes et éviter la maintenance excessive. Ces avancées sont pourtant loin d’être généralisées : 25 % des entreprises françaises
[1] La valeur de la fiabilité, enquête réalisée par ABB et Sapio Research, juillet 2023
[2] The True Cost of Downtime 2024, Siemens